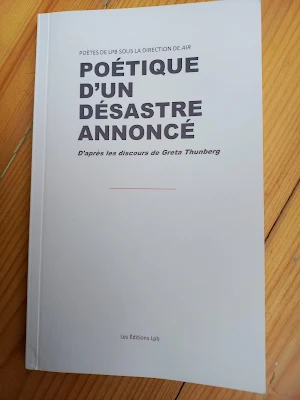Habitant de nulle part,
originaire de partout. Voilà un beau titre du poète Souleymane
Diamanka et une belle profession de foi dévouée à l’interculturalité. Dès
l’enfance il écoute les cassettes enregistrées par son père Boubacar : des
chants peuls, des contes et légendes, des récits, des dictons. Cette mémoire-là,
gravée sur ces petits rectangles de plastique, aussi fragiles que précieux. La
voix des ancêtres et des griots vibre jusque dans les silences, avec ses joies
et ses douleurs. Une leçon de philosophie, où l’âme n’est pas qu’une
abstraction mais un état de l’être pour vivre l’ordinaire des jours dans le
partage. La mère du poète, Diénéba, incarne au quotidien le flux des proverbes
magnétiques. Avec humour et tendresse. « Ko yotere huli, juꬼgo
suusi. », dit-elle à ses garçons comme à ses filles au moment de faire la
vaisselle. « Ce que ton œil craint, ta main peut l’affronter. »
Être ensemble, avec les
autres et pour les autres, avec les yeux qui perçoivent et les mains qui
agissent, au plus près des corps et des cœurs. Pour tenir mieux dans la haute
tour de la cité des Aubiers, cette banlieue de Bordeaux qui est un lieu mis au
ban. Et recomposer l’histoire de l’exil depuis les rivages du Sénégal en 1974.
Sans repli ni mélancolie. Les yeux qui savent regarder apprivoisent les
craintes irraisonnées. Les mains qui savent toucher ne fuient pas les
situations difficiles.
Puis Souleymane entre à
l’école du quartier. À sept ans, dans le car d’un voyage en partance vers la mer, il dit à voix
haute : « Le ciel est monotone. » Le paysage constitué comme une
émotion affleure déjà la contemplation. L’année suivante, la rencontre avec un
jeune instituteur qui enseigne en rêvant encourage cette conscience précoce des
sons et des sens. Des mots dits aux mots écrits, un chantier s’ouvre, un
mouvement bouscule les lignes qui ne sont jamais droites. Elles font des nœuds dans
le poème et « le lecteur doit essayer de les défaire », aurait dit le
maître.
Être humain autrement.
Encore un beau titre. Encore une belle profession de foi. Ce souhait, qui
devient conviction bien ancrée et encrée pour agir, se profile dès
l’adolescence dans la psyché du poète. Souleymane
Diamanka a 17 ans en 1991 et ne va pas « sous les tilleuls verts de
la promenade » chère au jeune Rimbaud. Le paysage urbain de la cité (la
téci), avec ses dalles suspendues et ses arbres asthéniques au milieu du bitume,
lui colle à la peau. Il découvre le smurf et le hip-hop. Le smurf est
« une danse saccadée, à mouvements stroboscopiques et à figures
acrobatiques réalisées au sol » selon la définition de l’Encyclopædia Universalis.
Il s’intègre au hip-hop venu du Bronx où tant de desdichados font enfin
entendre leurs clameurs. Pour être humains autrement, en embrassant les
musiques ouvertes à tous les rythmes, à tous les sangs. Souleymane rejoint le
groupe de Djangu Gandhal et monte sur la scène du Printemps de Bourges. C’est
le début d’une longue aventure, du rap au slam sur les scènes du collectif 129H à Paris. Les
rimes en ricochets s’enlacent aux gestes quand le poète se met à jongler. Ses
cinq balles dessinent dans la lumière des essais de constellations et il a le
sourire étoilé. Le pire n’est jamais certain. « La poésie a déjà sauvé le
monde », écrit-il dans un numéro de l’Ormée, revue culturelle à Bordeaux. Elle
le sauvera encore. Souleymane est un auteur camusien. Il pense qu’ « il
y a davantage à admirer chez l’homme qu’à mépriser ».
En trente ans de colportages
poétiques dans la France des oubliés mais aussi en Éthiopie, au Sénégal, à Delhi
et Pondichéry, il anime des ateliers d’écriture hybrides avec d'autres intervenants (Musique Assistée par
Ordinateur, danse, ateliers D.J…). Il dit : « J’ai appris en enseignant.
En essayant de transmettre ma passion le plus simplement possible ». Avec cette
phrase si juste que tout pédagogue devrait garder en
tête : « Each One Teach One. » Côtoyer des artistes
célèbres comme Grand Corps Malade, CharlÉlie Couture, Oxmo Puccino et Kenny
Allen parmi d’autres ne détourne pas le poète du chemin qu’il a choisi
d’entretenir. Celui des lieux dans les écarts où les mots se reconnaissent à
peine le droit de se dire même quand la vie va bien. « Pour ne pas que les
bâtiments s’enfuient / La nuit nous les gardions / Nous étions les bergers
immobiles / D’un bétail de béton », écrit Souleymane Diamanka. De toute
évidence, le berger a pris la route et sème à la volée des fleurs sur le béton.
L’Hiver peul.
Ce premier titre de la discographie de Souleymane Diamanka paraît en 2007 chez
Barclay. Avec, notamment, la voix et la musique de John Banzaï. Qui prolonge un
livre à quatre mains paru aux éditions Complicités : J’écris en
français dans une langue étrangère. Parmi les titres de l’album, notons L’art
ignare. « Les anciens ont-ils appris le solfège pour chanter la soul ? »,
demande le poète. Tout savoir étant maillé par l’ignorance, y compris sur les
estrades professorales, le message est une fois encore pétri d’humanisme. Le
« mauvais élève » peut se saisir de son ignorance comme d’un tremplin
vers l’art et tirer un trait sur son assignation au mépris trop longtemps
enduré.

Autre titre éloquent que Marchand
de cendres ! Dans un club de jazz, Souleymane fume la cigarette tendue
par une inconnue en haut d’un escalier. Son cœur bat. La belle a tiré une
bouffée et il pose ses lèvres là où elle a posé les siennes. Ah ! S’il
pouvait la rencontrer dans la rue et l’embrasser pour de vrai ! Le désir
amoureux, petit feu d’étoupe ou grand brasier d’artifices, éclot à l’improviste
n’importe où n’importe quand, et la mémoire s’en souvient. « Si nos
souvenirs s’endorment c’est que nos mémoires sont des chambres »,
constatent le poète. Des chambres fortes. Des chambres stériles. Des chambres
closes. Pourraient-elles, mal ouvertes, engendrer un hiver peul ? « Mon
baobab généalogique a ses racines en Afrique / et sa cime en Europe / Le tronc
de ses traditions a ses faiblesses et ses forces / Mais les orages identitaires
abiment son écorce ». La dimension politique de ces vers, en 2024, est
plus que jamais d’actualité. D’un bord à
l’autre de l’océan, l’arbre est en souffrance. Parfois il s’embrase. « Les
prisonniers de la misère » aux « joues creuses » ne sont pas les
bienvenus chez les sédentaires. Leur langue même, « dans [la] brousse urbaine et hostile »,
se hérisse de barbelés…
L’Hiver peul reçoit
un accueil très favorable de la presse nationale et confère à Souleymane
Diamanka une notoriété méritée. En 2014, il sort un single dédié à sa mère, Le
Vœu exaucé de Diénéba puis, deux ans plus tard, Être humain autrement.
Ce nouvel album est également salué par la critique. Et ses mots voyagent au
long cours, de New York à Durban, de Bamako à Lisbonne en passant par San Sebastian.
Pour rappeler cette vérité universelle trop souvent ignorée :
« L’humanité ne compte qu’un seul peuple vu de tout là-haut / Un seul
peuple avec plusieurs langues, plusieurs cultures et plusieurs couleurs de
peau ».
Ecrire à voix haute.
Ce livre écrit en 2012 avec Julien Barret [décrypte les images et les jeux de
sons du poète, dévoile les ressorts d’une esthétique qui voisine avec celle des
troubadours, des poètes romantiques ou de l’OuLiPo]. « Au fond, la poésie,
pour Souleymane Diamanka, sert à remettre la matière du monde dans les mots, si
bien que l’univers tient tout entier dans certains de ses vers », écrit le
linguiste spécialiste du rap et du slam. Sachant que l’univers est un tout sans
fin dans sa matière comme dans son énergie et que chacune de ses parties peut
constituer un tout en soi, la main de l’homme par exemple est à la fois un tout
et une partie dans le corps, il s’agit là d’une quête depuis les commencements
de l’humain nomade. Qui désire tutoyer les étoiles aussi bien que la terre où
vont ses pas et ses mots. Contrepèteries,
mots-valises, calligrammes, calembours, palindromes sont autant de jongleries dans
la vibration des sons et des sens. Et le troubadour, d’un pôle à l’autre du
visible et de l’invisible, trouve parfois sans chercher. C’est toute la magie
de la langue, celle des ancêtres chevillée à celle des contemporains, en ses
rhizomes qui font pousser des fleurs. Quelques-unes d’entre elles ont
aujourd’hui des résonnances qui ne sont pas toujours bleues. Le littORAL est
souvent assourdissant quand « Le navire des rêveurs s’est renversé »,
à Ceuta et Melilla, à Calais… Le palindrome « RUE PÂLE INERTE L'ÊTRE NIE LA PEUR» se déroule comme une scène où les feux de la rampe sont éteints. Entre
chiens et loups, une solitude marche dans une rue où rien ne bouge. Pas même
les ombres des néons. Le « sud conscient » refoule la peur au-delà du
subconscient. Il faut marcher. Marcher encore. [La lumière qui soigne] est à
portée de main et de plume. « La littérature est une bénédiction / Ici on
parle poésie urbaine et diction ». Seulement voilà ! Le corps de
l’écriture et le corps du poète ne jouent pas toujours de la même tessiture dans
leur ossature. La grammaire des mots est en retard sur celle du sang. « S’ouvrir
à se faire aimer » intime à l’intime de marcher encore et encore. C’est un
« rêve errant ». Une « correspondance des sables du
désert » avec les « corps responsables des danses du désir ». Une musique des vents qui sculptent des roses
et en sourdine la pulsation feutrée d’un tambour. « La peau hésitante, là,
pantelante / La poésie tente la pente lente. »
One Poet Show.
Ainsi s’intitule le nouveau spectacle du « Peul bordelais aux cordes
vocales barbelées », primé en 2023 au festival d’Avignon. L’idée lui en
est venue après son adaptation en slam du Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare. Côté jardin, une table sur tréteaux figure le lieu où le poète
écrit. On y voit, parmi des feuillets épars, un poste radio cassette et une
sphère posée sur un trépied fragile. Devant la table, quelques boules de papier
froissé jonchent les entours d’une corbeille où sont cachées quelques
surprises. L’imaginaire du spectateur papillonne de la sphère jusqu’aux boules,
met à l’épreuve la consistance du monde et de l’écriture. Côté cour, à même le
sol, les balles du poète invitent lentement le regard à formuler des
hypothèses. Et, sur le pendrillon du fond, un écran montre des paysages de
ville ou de savane, à grands traits figuratifs ou abstraits signés Jean-Marc Lejeune.
Un personnage, tout à ses vagabondages, en souligne les mouvements furtifs.
Le spectacle commence avant
l’entrée en scène de Souleymane. La mémoire des sons éveille la mémoire des
songes. Du port de la lune à la corne de l’Afrique en passant par le mont
Ararat, Alex Verbiese, Kenny Allen et Woodini, Zhirayr Markaryan offrent des arcs-en-ciel aux [enfants qui chantent
les mélodies de l’âme]. Cependant que la voix musicale du grand sage malien Amadou
Hampâté Bâ égrène ses perles. « La beauté d’un tapis réside dans la
diversité de ses couleurs ». Ici-bas comme là-haut, l’espoir est un
ouvrage car « c’est toute l’humanité qui s’ouvre à l’art et crée ».
Puis le poète apparaît lentement
côté jardin. Il regarde l’écran où ondulent quelques sautes de vent, il regarde
le public suspendu à son souffle. Il dit ses vers. Même ses yeux les disent. Mais
Souleymane Diamanka n’est pas un orant dévorant les arpents du plateau. Il se
retire derrière sa table d’écriture, griffonne et chiffonne quelque feuillet
lancé dans la corbeille à secrets. Puis il revient vers les spectateurs et sa
voix les caresse. Un trait d’humour fuse. Des rires lui répondent. Des rires
d’enfants et de grands-mères. Le poète est aussi attaché aux liens
intergénérationnels de la famille universelle. Il propose des jeux de gestes et
des jeux de mots, le sourire en bandoulière, et il improvise un poème. Minuscule
comme une perle, vaste comme une sphère.
La dernière touche.
Aucune composition n’est jamais complète mais il y a toujours une dernière
touche qui la tient ensemble. Au cours de ses pérégrinations et de ses
rencontres, celle parmi d’autres d’Alain Mabanckou qui lui a ouvert les portes
de sa prestigieuse collection de poésie aux éditions Points, il s’est essayé au
cinéma dans des fictions et des documentaires dont Les Enfants d’Hampâté Bâ d’Emmanuelle
Villard et Les poètes sont encore vivants de Xavier Gayant. Curieux de
tous les chantiers, il a répondu à l’invitation de Caroline Decoster du Château
Fleur Cardinale à Saint-Emilion pour écrire un poème sur l’œuvre des vignerons.
Mais venons-en à cette dernière touche. Souleymane se souvient de son One
Poet Show à Auroville en Inde. Il dit : « C’était dans une petite
salle, à la fin chaque personne du public est venue vers moi et m’a pris dans
ses bras, parfois sans dire un mot. » Que serait la poésie sans les
silences qui la grandissent ?
Dominique Boudou
Notes :
-
Habitant de nulle part, originaire de
partout, éditions Points, 2021
-
De la plume et de l’épée,
éditions Points, 2023
-
Prix littéraire des lycéens de la région
Île-de-France, 2021
-
Dernier One Poet Show au Rocher de
Palmer à Cenon près de Bordeaux, 2024
-
Souleymane se produira au musée de l’Orangerie
dans la salle des Nymphéas de Monet le 23 juin 2025 à 19h et 20h30.




.jpg)